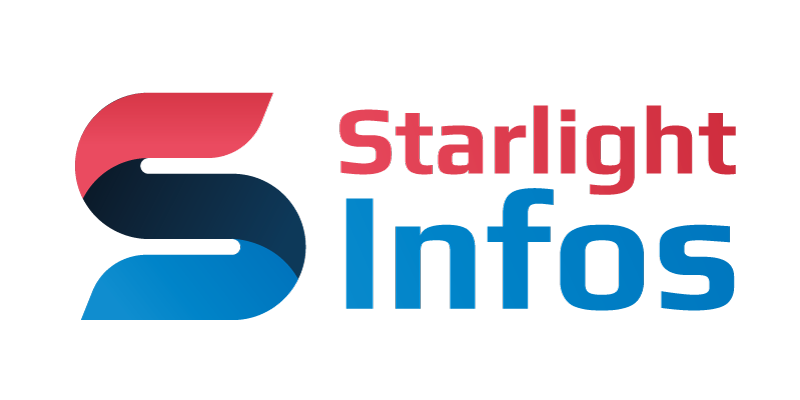En 2022, l’Agence nationale de sécurité sanitaire a recensé une augmentation de 38 % des signalements concernant les chenilles processionnaires. Les arrêtés municipaux imposant des mesures de lutte se multiplient, malgré des résultats souvent limités. La réglementation européenne classe désormais ces insectes parmi les espèces nuisibles à la santé publique.
La prolifération s’observe sur tout le territoire, du littoral atlantique jusqu’aux zones urbaines. Les services de santé rapportent chaque année des centaines de consultations liées à leurs poils urticants, tandis que les forestiers constatent des dégâts croissants sur les pins et les chênes.
La chenille processionnaire, un envahisseur discret mais redoutable
La chenille processionnaire avance masquée, profitant des premiers frimas pour s’installer sans bruit. Elle tisse ses cocons d’un fil soyeux dans les aiguilles du pin ou du chêne, grimpe sur les branches, s’adapte à tous les environnements, des forêts du sud-ouest aux squares des grandes villes, jusqu’aux boisements du nord de la France. Sa progression s’opère à bas bruit : aucune frontière ne l’arrête, ni barrière urbaine ni climat tempéré.
Dans les hauteurs, ces insectes nuisibles se déplacent en longues files. Leur nom vient de cette étrange marche collective, sinueuse et presque hypnotisante, qui trahit leur passage. Les experts notent une hausse continue des signalements chaque année. Qu’il s’agisse de la chenille processionnaire du pin ou de celle du chêne, la menace ne fait pas de distinction et pèse sur la biodiversité locale.
Leur présence n’est pas anodine pour les arbres. Les colonies s’attaquent au feuillage, ralentissent la croissance, ouvrent la porte à d’autres maladies. Les forestiers voient chaque printemps de nouvelles parcelles touchées, parfois sur plusieurs hectares. Dans la liste des espèces invasives, la chenille processionnaire coche toutes les cases d’un fléau moderne.
Pour mieux comprendre les conséquences de leur installation, voici les principales répercussions observées :
- Défoliation rapide des pins et des chênes
- Capacité d’adaptation à plusieurs essences d’arbres
- Expansion favorisée par le réchauffement climatique
La menace déborde largement les forêts. Jardins privés, aires de jeux, abords d’écoles : aucun espace vert n’échappe à leur expansion. L’alerte est claire : la vigilance de tous devient indispensable pour contenir cet adversaire silencieux.
Quels dangers pour les arbres et la santé humaine ?
La chenille processionnaire frappe sur deux fronts distincts. D’un côté, elle fragilise les arbres, principalement le pin et le chêne. Les colonies grignotent les aiguilles, appauvrissent la canopée, freinent la croissance. Les forêts touchées s’éclaircissent, deviennent plus vulnérables aux parasites et aux maladies. Un hiver suffit à constater les dégâts : feuillage jauni, rameaux nus, arbres en souffrance. L’équilibre forestier se retrouve compromis.
De l’autre, la santé humaine et animale subit de plein fouet l’effet des poils urticants. Légers, ils se dispersent dans l’air, s’accrochent aux vêtements, irritent la peau et les muqueuses. Au moindre contact, ils déclenchent des réactions allergiques : démangeaisons, éruptions, conjonctivites, voire gêne respiratoire. Les enfants, en particulier lorsqu’ils jouent dehors, y sont particulièrement exposés. Les animaux domestiques, chiens, chats, ne sont pas épargnés : œdèmes, nécrose linguale, urgence vétérinaire s’enchaînent parfois après une simple promenade.
Voici les principaux risques à prendre en compte :
- Atteintes oculaires et respiratoires possibles chez l’humain
- Complications parfois graves pour les animaux de compagnie
- Fragilisation durable des arbres touchés
La surveillance s’impose dès les premiers signes. Les soignants rappellent l’importance d’éviter tout contact, d’informer les habitants, d’agir sans attendre. Lorsque les poils urticants se disséminent, la réactivité est la meilleure arme.
Reconnaître sa présence : signes et périodes à surveiller
On repère la présence des chenilles processionnaires en observant d’abord les nids qu’elles laissent derrière elles. Ces assemblages blancs et soyeux s’accrochent à l’extrémité des branches de pins ou de chênes, formant des cocons volumineux bien visibles en hiver. Leur aspect cotonneux ne laisse guère de doute : l’arbre subit une attaque.
La période à surveiller s’étend de janvier à mai pour la chenille processionnaire du pin. Les nids se forment en hauteur, puis, avec les premiers redoux, les chenilles quittent leur abri pour descendre en file indienne, entamant leur fameuse procession. Cette démarche caractéristique, visible au sol ou sur les troncs, marque le pic de leur activité. Les zones infestées voient alors apparaître des colonnes de chenilles, parfois sur plusieurs mètres, parcourant les chemins ou les pelouses.
Pour identifier rapidement une infestation, voici les signes qui doivent alerter :
- Nid volumineux suspendu à la pointe des branches
- Processions de chenilles visibles au début du printemps, au sol ou au pied des arbres
- Aiguilles rongées, branches partiellement ou totalement dénudées
Une attention particulière doit être portée aux arbres isolés, aux lisières et aux espaces verts urbains, où les chenilles trouvent souvent des conditions idéales. La présence de nids chenilles processionnaires dans ces zones appelle à la prudence, surtout lors des journées ensoleillées où leur activité s’intensifie. Si le sud et l’ouest de la France demeurent les plus exposés, la progression vers le nord ne fait plus de doute.
Prévenir et agir : les solutions efficaces face à l’invasion
Anticiper l’expansion de la chenille processionnaire demande de conjuguer surveillance et action collective. Le piégeage mécanique fait office de première ligne de défense : des collerettes installées autour du tronc capturent les larves pendant leur descente. Ce procédé simple, respectueux du milieu naturel, limite la dispersion au sol.
Agir sans nuire à la biodiversité locale suppose de privilégier des alternatives biologiques contre la chenille processionnaire. Le Bacillus thuringiensis, appliqué en début d’automne sur les aiguilles, cible spécifiquement les larves et interrompt leur développement, tout en préservant les autres insectes. Les traitements chimiques, eux, exposent trop d’espèces non ciblées et sont donc à écarter autant que possible.
Encourager la présence de prédateurs naturels s’avère aussi payant : mésanges, chauves-souris, guêpes spécialisées contribuent à réguler les populations de chenilles. Installer des nichoirs, maintenir des haies, favoriser la diversité végétale autour des espaces boisés : autant de gestes qui renforcent l’équilibre écologique.
Les mesures suivantes permettent d’intervenir de façon concrète, en limitant les risques :
- Élagage des nids : pendant l’hiver, supprimer les nids manuellement, en évitant tout contact avec les poils urticants grâce à un équipement adapté.
- Information du public : sensibiliser les riverains et les gestionnaires d’espaces verts à la reconnaissance des nids et aux précautions à adopter.
La lutte contre la chenille processionnaire ne peut reposer sur un acteur unique. Forestiers, collectivités, particuliers : la surveillance régulière, la diversité des modes d’intervention et la préservation de la vie sauvage forment un levier collectif pour freiner ce fléau. Reste à chacun d’y prendre sa part, avant que les processions ne deviennent la norme sous nos arbres.